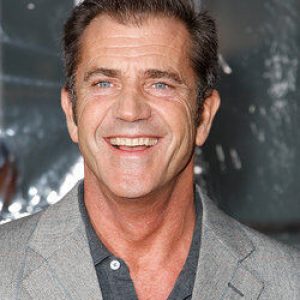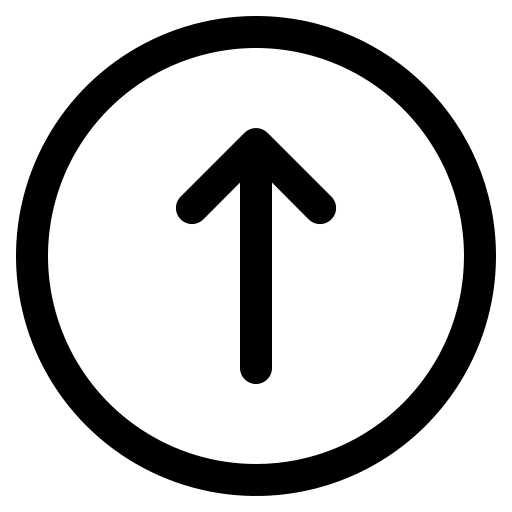Mel Gibson
Mel Gibson cinéaste ou le Démon de la mauvaise foi
Dossier par Jean-Philippe Costes

Jésus recommandait à ses fidèles de tendre la joue gauche quand on leur frappait la joue droite. Cet enseignement, Mel Gibson a eu tout loisir de le mettre en pratique. Les deux longs-métrages qu’il a réalisés entre 2004 et 2006 lui ont ainsi conféré les titres peu glorieux de Saint Patron de la violence gratuite et de prophète maudit de la haine du genre humain – haine dont les Juifs seraient les premiers exutoires.
Il est vrai que la Passion du Christ et Apocalypto ont tout pour susciter la controverse. Le premier film montre les aspects les plus sordides des dernières heures de la vie du Messie. Le second relate les sanglantes aventures d’un jeune Indien qui tente de sauver les siens de la barbarie Maya. Dans ces deux fresques, Gibson n’épargne rien au Spectateur : non seulement il lui inflige des scènes d’une violence inouïe mais en plus, il fait durer le déplaisir jusqu’à l’insoutenable. En soi, un tel parti pris est de nature à justifier l’opprobre qui a couvert la star Hollywoodienne. Ce triste sort paraît d’autant plus légitime que le réprouvé, accusé d’être un alcoolique impénitent et un suppôt de la droite ultraconservatrice, ne passe pas pour un digne représentant de l’Intelligentsia Américaine.
La Raison exige néanmoins de dépasser le stade primitif des jugements d’Inquisition et de procéder à une analyse plus objective des faits. Ce qui heurte le sens critique, lorsqu’on examine la Passion du Christ et Apocalypto, c’est le contraste saisissant qui fait cohabiter, à l’intérieur de ces films, de remarquables forces et de coupables faiblesses. Ces œuvres sont ainsi émaillées de maladresses récurrentes. Outre une esthétique inégale, elles souffrent essentiellement d’une candeur des plus préjudiciables. Le phénomène est patent dans la séquence finale d’Apocalypto : le Spectateur y voit sans aucun recul le débarquement « providentiel » des Chrétiens d’Europe, venus répandre la bonne Parole dans « l’Amérique des sauvages ». Cette propension à la naïveté se traduit également par une difficulté chronique à manier des instruments aussi fondamentaux que le symbolisme, le non-dit et le hors cadre. Il en résulte des plans d’une violence superflue, qui desservent les ambitions intellectuelles et artistiques de l’auteur. Plus fâcheuse encore est l’insouciance qui a conduit Mel Gibson à filmer la Passion du Christ sans prendre la précaution élémentaire d’expliquer les enjeux politiques et religieux de l’époque. En l’absence de ce travail de contextualisation, il était évident que le film, aussi « innocent » fût-il, serait l’objet d’un procès en antisémitisme.
Tout ceci ne saurait pourtant occulter les qualités de Mel Gibson. Ses films se distinguent ainsi par une intensité dramatique peu commune. Ils sont par-dessus tout le théâtre de scènes impérissables : qui peut rester insensible devant ce Christ agonisant, qui endure sans rancoeur les supplices que lui infligent des bourreaux inhumains ? Qui peut rester de marbre face au spectacle à la fois ignoble et fascinant de cette civilisation Maya qui, minée par la décadence, sacrifie des hommes avec délectation avant de jeter leur corps démembré dans de gigantesques fosses communes ?

À l’évidence, seul un véritable artiste peut être l’auteur de ces images dantesques. La meilleure preuve de cette assertion est que Mel Gibson tient manifestement un propos rationnel et cohérent. Ainsi, ses deux films majeurs témoignent d’une volonté constante de porter la Parole divine. Certains lui ont d’ailleurs reproché de l’avoir profanée en montrant des atrocités innommables. Mais n’en déplaise à ses contempteurs, dont beaucoup n’ont, semble-t-il, jamais lu la Bible, le cinéaste a toujours respecté la pureté de ses sources d’inspiration.
Comme la souffrance, la Violence est en effet partie intégrante de la Vérité révélée. L’étude de l’Ancien Testament le démontre. L’exégèse du Nouveau Testament, qui constitue la trame de la Passion du Christ, en apporte la confirmation. On peut même se risquer à dire que le binôme souffrance / brutalité participe de l’essence même du message évangélique. Ainsi, la « bonne nouvelle » que Jésus de Nazareth a la lourde charge d’annoncer est que Dieu l’a mis au monde, lui a fait vivre les misères de la condition humaine et l’a soumis aux tourments de la Mort afin de racheter les méfaits de Ses créatures. Dans cette perspective, le calvaire du Christ signifie que Dieu pardonne le Péché originel et prend sur lui toutes les fautes de l’Humanité. Telle est la raison pour laquelle Gibson a choisi de ne rien cacher du martyre du Messie : en Chrétien convaincu, il a voulu mettre des images sur les Saintes Ecritures et ainsi, redonner corps à l’esprit du texte sacré.
Une violence similaire se retrouve au sein de l’Apocalypse selon Saint Jean, que Mel Gibson a transposé à l’écran dans Apocalypto. Là encore, il suffit de lire la Bible pour s’apercevoir que le réalisateur ne s’est pas tant livré à une surenchère dans l’horreur qu’à une simple transposition d’un texte incroyablement dur. Une fois accomplie cette mise au point théologique, les accusations d’apologie de la violence gratuite, qui n’ont cessé d’être portées contre le long-métrage, perdent une grande part de leur sens.
Elles apparaissent d’autant moins pertinentes qu’à l’instar de son modèle biblique, le film poursuit un but précis : « révéler » la fin prochaine d’un monde corrompu et l’avènement du royaume de Dieu. Un tel propos ne relève pas simplement du domaine de l’ésotérisme. S’il s’inscrit effectivement dans une tradition prophétique, il est également la traduction d’un projet politique. Dans l’Apocalypse, ce plan consistait à raffermir le moral des Chrétiens affligés en leur promettant la chute de la tyrannie Romaine. Dans Apocalypto, on ne peut s’empêcher de penser que la civilisation décadente des Mayas est une allégorie des États-Unis, pays autrefois glorieux qui, miné par l’Utilitarisme et l’Impérialisme, recherche à présent la voie de la rédemption. Une rédemption qui, dans l’esprit de Mel Gibson, suppose un retour aux valeurs du Christianisme…
Être un autre ou ne pas être…
Cette représentation conservatrice et religieuse du monde peut sembler détestable à des esprits laïcs et progressistes. Cependant, affirmer que l’œuvre de Gibson n’est que haine stérile et ruine de l’esprit serait intellectuellement malhonnête. Ces deux derniers mots nous amènent précisément au fond du problème. Car en définitive, de quoi l’auteur d’Apocalypto et de la Passion du Christ est-il coupable aux yeux de ses détracteurs ? D’avoir voulu être un auteur, capable de défendre une conception personnelle du monde. Tout est là : la Critique veut que l’autodidacte mette en scène des longs-métrages standardisés comme Braveheart, tandis que le Public attend du héros Hollywoodien qu’il se cantonne dans son rôle d’acteur. Autrement dit, chacun désire que Mel reste docilement dans l’ombre de Gibson. Bons ou mauvais, les futurs films de la Star Australienne ne changeront probablement rien à cette malédiction des étiquettes. Le créateur damné peut néanmoins se consoler, son cas d’espèce touche à l’Universel. Il nous rappelle en effet que pour être lui-même, l’Artiste doit accomplir un véritable miracle : exorciser le Démon de la mauvaise foi qui bouillonne au plus profond des âmes.
Article écrit par :
Jean-Philippe Costes